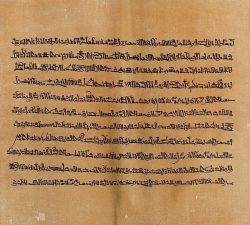Tout savoir sur Jaffa
Nos restaurants préférés à Jaffa
Il n'est pas si simple de dénicher un bon restaurant à Jaffa. Les guides de voyage classiques recommandent inlassablement les mêmes adresses, devenues des "incontournables", comme la boulangerie Abulafia, le Dr. Tchachuka, Itzik Hagadol ou encore le Houmous d'Abu Hassan. Avec l'essor du tourisme de masse, les établissements de qualité médiocre se sont multipliés, transformant de nombreux restaurants en pièges à touristes.
Heureusement, il reste encore quelques pépites à découvrir. Voici quelques adresses qui pourraient vous plaire.
Cafe Puaa
Situé dans une petite ruelle, ne vous étonnez pas des tables et des chaises désuètes et dépareillées. Le café Puaa est en réalité décoré de meubles d'occasion chinés au marché et ils sont tous disponibles à la vente. La carte n’est pas spécialement originale mais son ambiance bohème arrive à sublimer l’endroit. Si même le Haaretz le recommande, vous pouvez y aller sans hésiter.
Burekas Leon
Si vous êtes à la recherche de bourekas, ces petits feuilletés dont raffolent les Israéliens, ne manquez pas Leon and Sons, une véritable institution à Jaffa. Cette bourekasiya familiale d'origine bulgare est ouverte depuis des décennies et se distingue par ses bourekas préparées selon une recette traditionnelle. La pâte phyllo faite maison, incroyablement feuilletée grâce à l'utilisation de vrai beurre, et ses garnitures généreuses font sa réputation. Attendez-vous à une petite file d'attente, mais l'attente en vaut la peine.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les bourekas, n'hésitez pas à lire notre article "Qu'est-ce qu'un bourekas ?".
La boulangerie Hasan Basha
Tous les guides touristiques recommandent la boulangerie Abulafia à Jaffa, mais la véritable pépite se trouve à quelques mètres de là. C'est à la pâtisserie Hasan Basha que les locaux, notamment les Palestiniens de Jaffa, se retrouvent pour déguster le célèbre knafeh. Si vous n'êtes pas diabétique, ne manquez pas ce dessert au fromage palestinien. C'est une expérience inoubliable !
Restaurant Dani
Pour les amateurs de gastronomie locale, plutôt que de vous rendre au célèbre Dr. Tchachuka, osez traverser la rue et entrer chez Dani (Miznon Dani). Cette petite cantine, située à l'entrée du souk, propose une carte simple et délicieuse : houmous et ... frites ! Ces dernières sont particulièrement remarquables. Le restaurant sert également des kebabs et des brochettes préparés par son établissement d'en face. Très apprécié par les habitués comme par les touristes, le lieu propose des prix très abordables.